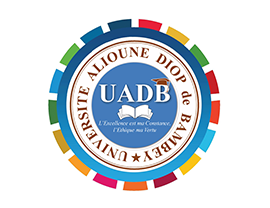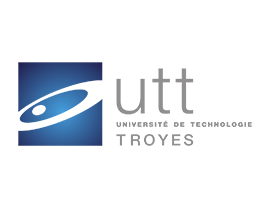Dans la continuité du partenariat entre le CFS, la Galerie du 19M et l’Institut Français de la Mode s’est tenu ce 2 mars un colloque international intitulé “Mode et savoir-faire : le Sénégal et au-delà”. En inscrivant cette manifestation dans la programmation hébergée par le musée Théodore Monod d’art africain, ce colloque a dressé les contours d’une histoire de la mode et des techniques, pensée depuis le territoire dakarois et au prisme de l’héritage sénégalais, mais aussi de celui de l’Afrique de l’Ouest et enfin, du continent.
Dans la continuité du partenariat entre le CFS, la Galerie du 19M et l’Institut Français de la Mode s’est tenu ce 2 mars un colloque international intitulé “Mode et savoir-faire : le Sénégal et au-delà”. En inscrivant cette manifestation dans la programmation hébergée par le musée Théodore Monod d’art africain, ce colloque a dressé les contours d’une histoire de la mode et des techniques, pensée depuis le territoire dakarois et au prisme de l’héritage sénégalais, mais aussi de celui de l’Afrique de l’Ouest et enfin, du continent.À rebours des récits canoniques, souvent conçus autour d’une seule centralité parisienne, ce colloque avait pour ambition de rassembler des chercheurs dont les travaux sur les techniques et savoir-faire de la mode permettent de saisir les spécificités d’une scène locale, inscrite dans un jeu d’échanges et de circulations globales.
Trois axes ont été abordés, sans être restrictifs :
· Les savoir-faire du Sénégal et leurs circulations
La place du Sénégal dans un commerce mondialisé – la circulation des matériaux, notamment textiles, depuis l’Asie (Chine, Inde) et l’Europe (Portugal, France), dans le contexte des compagnies marchandes dès le XVIIe siècle, et par la suite du commerce triangulaire. Le pendant contemporain de cette mondialisation avec les réseaux de marchandises de seconde main ou le made in China.
· Savoir-faire, patrimoine et identités
De l’introduction de la machine à̀ coudre par les français au XIXe siècle à la distinction entre « tenue européenne » et « tenue traditionnelle », comment se conçoit de l’indépendance à aujourd’hui, des identités nationales par la mode et le vêtement ? Des collections des musées et leurs artefacts (Theodore Monod) qui racontent l’histoire des techniques, aux références faites par les créateurs contemporains à des savoir-faire et motifs traditionnels, comment sont mis en récits ces héritages ?
· Mode africaine, création sénégalaise
Comment concevoir une mode africaine, historiquement et culturellement ? Les initiatives des chercheurs et musées, souvent occidentaux (par exemple : Africa Fashion, V&A, Londres, 2022) s’y attellent. Comment articuler initiatives régionales/nationales (fashion weeks) et celles continentales? Quelles cohérences et synergies entre acteurs locaux et récits continentaux, entre ‘mode africaine’ et ‘black fashion’ dans une économie mondialisée ?